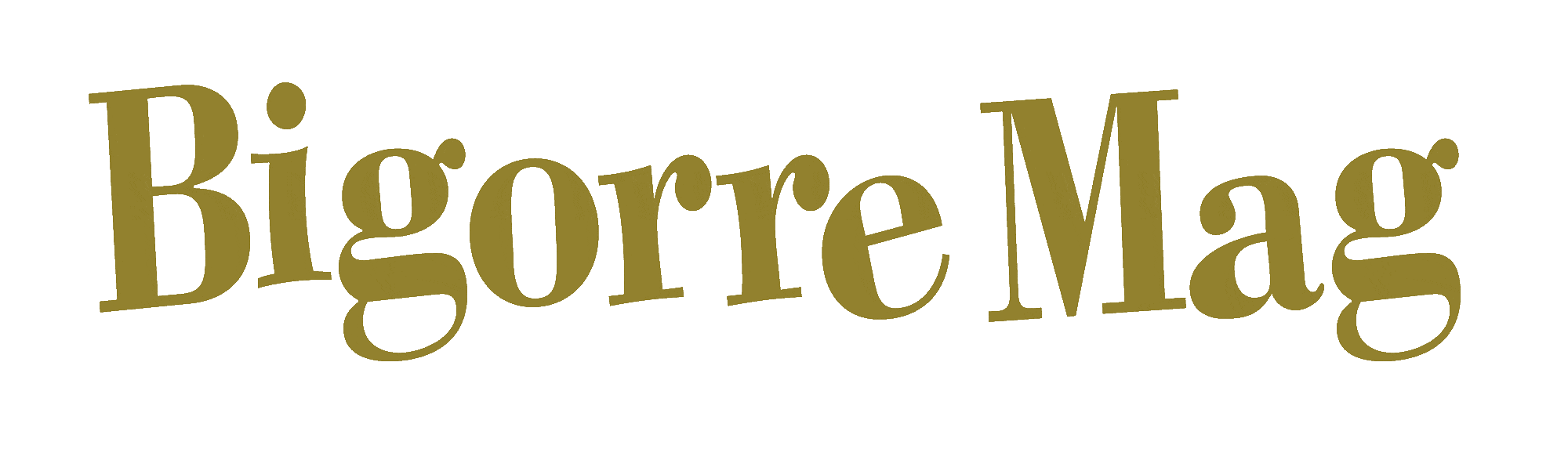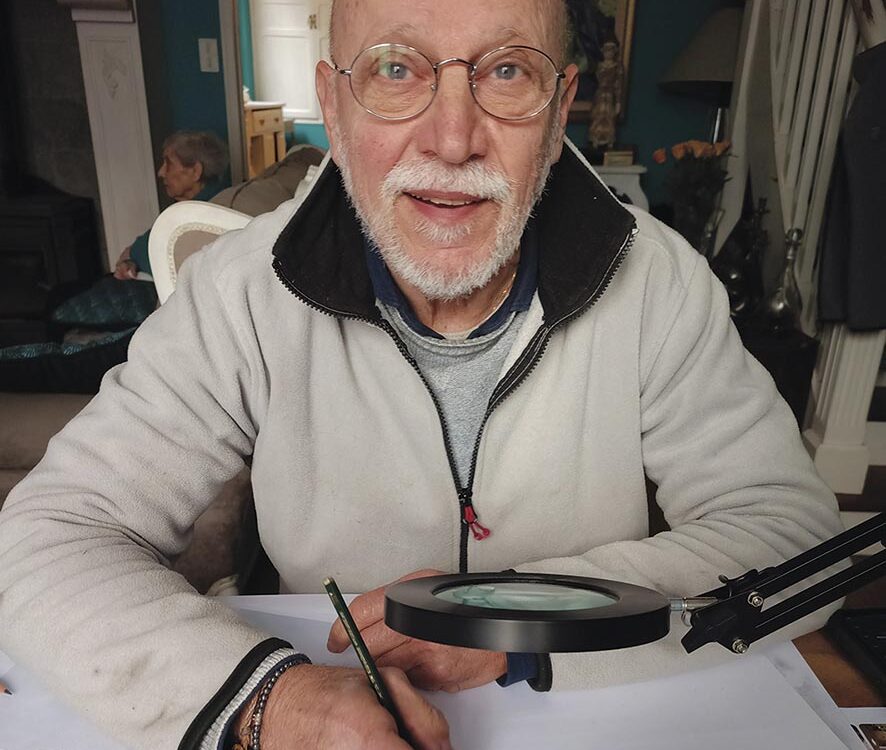Les métiers de demain Tentative d’identification des filières d’avenir…
janvier 6, 2021
Hugo Brouet Engagez-vous, qu’ils disaient…
janvier 18, 2021« Hier encore, j’avais vingt ans… » chantait Charles Aznavour il y a une soixantaine d’années, et tout cela ne nous rajeunit pas, dites donc. Maéva Mirol, notre jeune portraiturée de ce numéro spécial Formation, c’est aujourd’hui qu’elle a vingt ans ; et, à ce titre, elle appartient à cette grande catégorie de la population dont l’avenir du pays dépend, dont le présent n’est pas toujours simple, et qui, surtout, n’a pas connu ce passé dont ses aînés affirment sans trembler qu’il était bien meilleur : bah oui, vous ne le saviez pas ? La vie, c’était quand même vachement mieux avant !
Interrogez à ce sujet un quadragénaire, un quinquagénaire, un sexagénaire, un septuagénaire, la réponse sera quasi-invariablement du même ordre : « Ah, la musique qu’on écoutait, quand j’étais jeune, c’était quand même autre chose que le rap d’aujourd’hui ! » ; « A mon époque, on savait ce que travailler voulait dire, et on avait encore des valeurs » ; « Les politiciens n’étaient pas aussi nuls qu’ils ne le sont aujourd’hui » ; etc, etc. Et pourtant, entre un quarantenaire et un septentenaire, si l’on ne s’abuse, il y a bien trente ans d’écart ! Le quarantenaire et le septentenaire, ils n’ont pas été jeunes précisément à la même époque, si ? Il n’en demeure pas moins qu’ils ont tous deux la nostalgie de leurs 20 ans… Mais alors : ce qui rend une époque « belle », ce ne serait pas, non pas qu’elle se soit située dans les années 70, ou dans les années 80, mais le fait d’avoir eu, à ce moment-là, 20 ans ?
Ainsi va le monde
Revenons à Maéva : l’on voulait, en la rencontrant, et comme on l’a déjà précisé en édito (s’y rapporter si besoin), échanger quelques mots avec une jeune personne tout juste post-étudiante, tout juste nouvelle entrante dans la « population active » (comme dit l’INSEE), et, surtout, prochainement maîtresse du destin du monde. Eh oui. Les quinquas qui font la loi, aujourd’hui, seront à la retraite dans 20 ans. La génération de Maéva, c’est celle qui sera, à ce moment-là, aux manettes. Le monde d’après, c’est elle, c’est eux, les quinquas n’étant que les représentants du monde de maintenant comme les retraités actuels sont les représentants du monde d’avant. Ainsi va la vie, ainsi va le monde. On ne vous apprend rien en disant cela.
Biopix
Maéva Mirol, donc. Jeune auto-entrepreneuse travaillant dans le domaine de la photographie, de la vidéo et du graphisme. Etudes d’esthéticienne, d’abord, choix qu’elle avait fait en troisième un peu parce que, nous a-t-il semblé lors de notre discussion avec elle, elle n’avait pas vraiment encore trouvé sa voie, puis réorientation en Métiers du Multimédia et Internet à l’IUT de Tarbes, formation niveau licence qu’elle a bouclée en juin dernier. Famille unie, vivant dans une maison de campagne près de Tarbes. Des amis apparemment sympas. Un amour très affiché pour la côte (basque et landaise) où elle se rend souvent. Quelques voyages à son actif, notamment un en Inde, où elle a passé trois semaines l’an dernier. Un usage assez soutenu du numérique, mais qui n’en est pas là aujourd’hui ? Et puis, surtout : la photo.
Génération Z
Oui, la photo. Et c’est le moment que l’on a choisi, auprès de Maéva, pour vérifier quelques petites choses. On le sait, ceux qui sont nés avant les représentants de la génération Z (regroupant elle-même les individus nés aux environs de l’an 2000) nourrissent à l’endroit de celle-ci un certain nombre d’aprioris. En l’occurrence, en ce qui concerne le lien entre la photo et la jeunesse, l’image de jeunes filles utilisant leur smartphone à des fins de « shootings entre copines », ceux-ci savamment instrumentés pour nourrir leurs comptes Instagram, est désormais un cliché répandu. « Bien sûr, vers 14 ans, je suis aussi passée par là, précise Maéva. Mais c’était surtout pour moi une manière de trouver des images pour faire de l’édit. A cet âge-là, ça faisait déjà une bonne année que j’utilisais assidûment Photoshop et Photoscape, et je n’ai par ailleurs pas découvert la photo avec mon premier smartphone ! En fait, je n’ai jamais été vraiment adepte des photos prises sur un portable… »
Quand le désir s’accroît
La photographie, c’est en effet avec un appareil photo numérique que Maéva la découvre, à l’âge de 6 ans. « C’était celui de ma mère, celui dont elle se servait notamment lors qu’elle se portait volontaire pour accompagner des sorties scolaires. Vers 10 ans, c’est un peu devenu le mien. Vers 12-13 ans, je découvrais Photoshop, et commençais à passer de plus en plus de temps sur internet pour suivre des tutos photos et traitement de l’image. Je me suis documentée sur tout ce que j’ai pu trouver sur le sujet, sur internet, sur YouTube, dans des magazines… Je n’imaginais pas encore que ça puisse être un métier, mais c’était déjà une passion. »
Aprioris, toujours
Stop. Faisons une pause. Réfléchissons à un autre préjugé tenace concernant la jeunesse. Vous le savez sans doute, on la dit sensible aux « modes » et aux « tendances » ; or l’on se rend compte dans le récit de Maéva qu’elle est tout aussi persévérante que ne le sont ses aînés, lorsqu’elle se découvre une passion pour quelque chose, ici la photo, mais pourquoi pas autre chose encore ? Bon d’accord, d’accord, « you get the point », mais cette passion est-elle, chez les jeunes qui se la découvrent, suffisamment puissante pour qu’ils songent à en faire leur métier ? Maéva le reconnaît, de ce point de vue, elle est plutôt l’exception. On l’a interrogée, à nouveau, sur un autre apriori qui parvient fréquemment à nos oreilles : il paraîtrait que les jeunes sont de plus en plus nombreux à « dichotomiser » parfaitement les sphères personnelles et professionnelles, et que le travail, pour eux, ce n’est pas forcément un investissement qu’ils font avec le cœur, mais surtout un moyen de gagner un salaire pour financer, dans leur temps libre, ce qui véritablement leur plaît. Ce n’est pas faux, dit Maéva, mais n’était-ce pas également le cas des générations précédentes ? Combien parmi la population française des quinquas peut se targuer d’avoir un vrai « métier-passion » ?
C’est pour un sondage
Autres questions, posées à Maéva : c’est vrai que les jeunes lisent peu, que « l’inculture » se répand ? « D’accord et pas d’accord. Personnellement, je suis entourée d’amis qui sont très cultivés, et avec qui l’on débat de beaucoup de sujets, notamment sociétaux. Ils lisent peu de « gros livres », mais ils se documentent sur beaucoup de supports différents, numériques ou papiers, ainsi que je le fais… » ; c’est vrai que les jeunes passent trop de temps devant les écrans ? « Oui, ça c’est vrai. Mais aujourd’hui, les écrans, ça fait aussi partie de nos métiers. Quand je suis devant mon ordinateur, ce n’est pas pour occuper mon temps sur des « jeux en réseau », généralement, c’est parce que je travaille. Et quand j’utilise Instagram et Youtube, c’est aussi par souci de « veille créative », essentielle pour nourrir mes inspirations » ; c’est vrai que les jeunes se désintéressent de la politique ? « Je ne suis personnellement pas très renseignée sur la politique, mais je ne suis pas sûre que mon cas soit une généralité. » Etc, etc.
Et demain ?
Quand on lui demande si elle est optimiste quant à l’avenir, que ce soit le sien propre ou celui de sa génération, Maéva parle, naturellement, climat et éco-responsabilité. Elle-même assez concernée par la question, elle semble penser que ce n’est pas encore suffisamment le cas chez ceux de son âge, insistant toutefois : « je crois que c’est la même chose pour toutes les générations ». Est-on insouciant, quand on a 20 ans aujourd’hui ? « Pas vraiment. J’aimerais pouvoir dire que je suis optimiste, mais honnêtement, ce ne serait pas vrai. Je ne suis pas pessimiste pour autant : on vit un peu dans le flou par rapport à ce qui pourrait arriver plus tard… » Il est vrai que d’autres époques ont permis d’envisager plus sereinement des lendemains qui chantent ; avec le coronavirus, l’économie battant de l’aile, le chômage des jeunes qui s’amplifie, le climat qui se dérègle, il serait un peu fou d’espérer de nouvelles « trente glorieuses » jusqu’en 2050. Il n’empêche : il faut bien continuer, et il serait tout aussi fou d’arrêter de vivre par protestation ou par angoisse en attendant que les choses prennent un meilleur tournant.
Pas une étude
Voilà. Vous l’aurez compris, cet article ne se veut pas être une étude sociologique sérieuse de l’état de pensée des « jeunes » à l’heure où l’on vous parle. Avec une seule interlocutrice, et en si peu de pages, il n’aurait pas été sérieux d’y prétendre. Maéva Mirol n’a été ici qu’une voix, et non pas nécessairement toujours, au cours de notre conversation, la porte-parole de sa génération. Il nous a semblé, pourtant, à l’écouter, que la jeunesse de notre pays n’avait pas forcément à souffrir les préjugés qui la concernent, et qui sont colportés, souvent, par les générations antérieures. Certes les usages ont changé. Certes le numérique s’est immiscé fortement dans la vie de ceux qui sont nés après la démocratisation d’internet (et à propos du « numérique », Maéva, comme beaucoup d’ailleurs, s’inquiète parfois d’une dégradation possible des relations humaines « virtualisées »). Mais rien de ce que n’est le meilleur de la nature humaine n’a changé. Le désir est toujours là. La passion est toujours là. L’intelligence est toujours là. L’ardeur au travail est toujours là. Y a-t-il des raisons de s’inquiéter pour notre jeunesse ? Oui, certainement. Mais pas à cause des jeunes. Ils héritent, ne l’oublions pas, du monde que l’on leur laisse, d’un monde où le réchauffement climatique est de plus en plus inquiétant et où les dettes des états ne font que s’amplifier. On aurait beau jeu de leur faire la leçon : tout porte à penser qu’ils sont bien mieux placés, eux, pour nous la faire à nous (on se fait ici les représentants des autres générations).
On se lance : elle aussi
L’on voulait conclure par un petit clin-d’œil adressé à Maéva, qui ne peut pas être résumée à ses vingt ans. Jeune auto-entrepreneuse, on l’a dit plus haut, elle est aujourd’hui dans une situation qui nous a semblé être celle de « la halte à la croisée des chemins ». Photo, vidéo (on a peu insisté sur ce point, mais son travail vidéo, depuis quelques années, l’occupe énormément), communication : elle a certes plusieurs cordes à son arc, mais les circonstances sanitaires et économiques ne sont pas les plus favorables à la ratification de commandes. On n’est pas là pour lui faire de la pub, ce n’est pas l’objet de notre rencontre, mais rien ne sert non plus de faire de la rétention d’information : Maéva Mirol a un compte Instagram, où l’on peut suivre l’avancée de ses recherches, trouver ses réalisations… On vous laisse le lien en bas de page, vous en faites ce que vous voulez. On y trouve pas mal de photos de surf, amour de la côte oblige, une petite réal’ dans le désert des Bardénas (sympa), et diverses autres petites choses : n’espérez pas encore y découvrir une œuvre foisonnante ; à 20 ans, on débute, et c’est bien normal. Maéva Mirol a encore de nombreuses années devant elle pour faire ses preuves. Que les vents lui soient favorables : bonne route Maéva, et au plaisir !
Maéva Mirol sur Instagram :
@maevacuesonstyyle